Les « First Ladies » d’Afrique se mobilisent pour la santé ainsi que la nutrition de la femme et des enfants

Des premières dames africaines engagées aux côtés des femmes : de gauche à droite, Aïcha Buhari (première dame du Nigeria), Angeline Ndayishimiye (première dame du Burundi), et Salma Kikwete ( ex-première dame de Tanzanie). Crédits : Aboubakar Mounchili
Venir en aide aux femmes et enfants en Afrique, c’est un engagement de plus en plus marqué des premières dames africaines regroupées dans l’Organisation des premières dames d’Afrique pour le développement.
« Beaucoup parmi nous continuent à mourir en donnant naissance, le plus souvent à cause de l’extrême pauvreté. Les premières dames ont encore confirmé leur engagement à soutenir les actions des relais communautaires que nous sommes, à multiplier le plaidoyer pour le financement de la santé de la femme et des enfants aux côtés des pouvoirs publics. Cela arrive à point nommé » : comme de nombreuses participantes au 3e Forum de haut niveau des femmes leaders réunies ce mois d’octobre à Bujumbura, la capitale du Burundi, Irvine Ndikuma Ndizeye a accueilli avec satisfaction l’attachement des épouses des présidents du continent à l’amélioration du quotidien des femmes et des enfants. Cette élue locale, qui dirige également une coopérative agricole de plusieurs centaines de femmes dans la province de Kayanze située dans les hautes collines au centre du Burundi, participait au mois d’octobre dernier à une édition du forum sur le thème central « Santé et la nutrition de la femme, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent en Afrique ». Plusieurs épouses de chefs d’État en fonction, d’anciennes premières dames, telles Salma Kikwete de la Tanzanie, Sophie Buyoya, Denise Bucumi-Nkurunziza du Burundi, prenaient part à l’événement, ainsi que de nombreuses femmes leaders ou encore des experts et représentants des O.N.G. internationales et organismes des Nations unies. « Nous pouvons renverser la situation en suscitant plus d’attention sur ces couches fragiles et exposées que sont les femmes et les enfants. Nous pouvons amener à des changements dans la société. Si nous ne le faisons pas, et tant que ces couches ne seront pas bien assistées, nous rencontrerons toujours des difficultés dans nos pays », a expliqué Angeline Ndayishimiye, première dame du Burundi à l’initiative de l’événement.
Une problématique encore sérieuse
Le chemin reste encore long : « la question de la santé et de la nutrition de la femme et de l’enfant demeure toujours une préoccupation sérieuse, surtout dans certaines régions du continent », a indiqué Damien Mama, coordonnateur résident des Nations unies au Burundi. La multiplication des conflits armés, l’extrême pauvreté des populations et les effets du changement climatique enregistrés en Afrique en sont des explications, d’après de nombreux experts. C’est le cas, par exemple, au Nigeria avec l’insurrection de la secte terroriste Boko Haram. « Le nombre d’enfants de moins de 5 ans au Nigeria est évalué à environ 31 millions, dont près de la moitié souffrent de beaucoup de maux parmi lesquels la malnutrition, et c’est alarmant », a déclaré au cours de ce forum la première dame du Nigeria, Aïcha Buhari. Elle a insisté sur l’amélioration qu’apporte sa fondation au sort des plus jeunes enfants.
Car ces fondations de premières dames sont de plus en plus visibles : Dominique Ouattara avec Children of Africa en Côte d’Ivoire, Aïcha Buhari avec sa fondation au Nigeria, Marième Faye Sall au Sénégal avec la fondation Servir le Sénégal, ou Shaping our Future Foundation au Malawi. Chantal Biya au Cameroun a créé une fondation pour soutenir la recherche médicale ainsi que le Centre mère et enfant qui propose soins pédiatriques et éducation sanitaire, avec une prise en charge des enfants nés de mères vivant avec le V.I.H.. En République centrafricaine, on trouve la Fondation Cri de cœur d’une mère, de Brigitte Touadera, fondée en 2016. Et au Burundi, Angeline Ndayishimiye est devenue en deux ans seulement une figure incontournable des actions dans le domaine de la santé maternelle et infantile, sexuelle et reproductive des adolescents, l’autonomisation économique des jeunes et des femmes, ou encore du soutien au bien-être des personnes vulnérables.
Les effets de ces fondations sur les populations ne peuvent être niés : d’un côté, elles attirent des dons internationaux. De l’autre, l’aura des premières dames et leur influence présumée sur leurs époux font des miracles de mobilisation :« Nous savons que lorsque les premières dames s’impliquent, les résultats suivent, souligne le Pr Sylvestre Bazikamwe, gynécologue obstétricien enseignant à l’université du Burundi. Elles ont une grande influence sur d’autres femmes, une grande capacité de lobbying, de mobilisation d’attention autour des souffrances des femmes et des enfants en Afrique, et surtout de mobilisation des moyens, car il est aussi et principalement question de cela pour pouvoir gagner cette bataille ».
Des fondations qui amassent beaucoup d’argent
Reste que le financement de ces institutions apolitiques à but non lucratif et à vocation humanitaire, et qui partagent souvent la même histoire, n’est pas particulièrement transparent. On sait que leurs ressources proviennent en grande partie de divers philanthropes, de dons de mécènes, des O.N.G., d’organismes internationaux tels l’UNICEF, l’O.M.S., l’ONUSIDA, et même parfois de dons de matériel par d’autres premières dames, comme Peng Liyuan, l’épouse du président chinois Xi Jinping. Il est par contre difficile d’avoir une idée exacte de la quantité d’argent qu’elles collectent et surtout de la gestion de ces fonds. Reconnues d’utilité publique, ces institutions bénéficient de statuts particuliers avec des pouvoirs étendus pour la recherche de financements pour leurs activités et le soutien qu’elles apportent ainsi aux gouvernements.
Fortes de ces avantages, les premières dames mènent aujourd’hui en synergie des actions à l’échelle du continent et des plaidoyers auprès des décideurs. Elles ont ainsi créé plusieurs cadres de rencontres et d’actions, comme l’Organisation des premières dames d’Afrique pour le développement (OPDAD), Synergies africaines contre le sida et les souffrances, ou encore la Mission de paix des premières dames d’Afrique (MIPREDA). Cette organisation particulière, née en 1997 et dont la première dame du Nigeria, Aïcha Buhari, est la présidente, veut appuyer les efforts des chefs d’État pour consolider la paix. Un pas de plus vers un rôle plus politique ?

À voir aussi

Entretien avec Ikechukwu Anoke, dirigeant et co-fondateur de Zuri health
Un médecin pour 10 000 habitants, 65 % des utilisateurs de téléphones sans accès à internet : ZuriHealth répond à l'urgence sanitaire en Afrique avec des solutions innovantes et inclusives. Dans cet entretien, le PDG Ikechukwu Anoke présente cette plateforme d’hôpital virtuel accessible à tous, via SMS ou smartphone, qui rend les soins abordables, même à moins de 10 centimes par jour. Née d’une histoire personnelle, ZuriHealth est aujourd’hui active dans 9 pays et vise une présence dans les 55 États africains d’ici 3 ans.

Cosmétique beurre de karité made in Burkina
À Ouagadougou, le laboratoire Odiss Cosmétiques redonne vie aux peaux abîmées grâce à des ingrédients naturels 100 % locaux : beurre de karité, huile de neem, huile de baobab… Fondée par Denise Odette Konseiga, ancienne auxiliaire en pharmacie, cette entreprise made in Burkina s’impose comme une référence de la cosmétique réparatrice et responsable, dans un marché longtemps dominé par l’importation. 300 femmes mobilisées en coopératives, des gammes certifiées bio, une présence à l’international : Odiss mise sur le savoir-faire local et l’autonomisa Journaliste : Sonia KOCTY

Les start-up africaines préparent l’après-aide au développement
Cette année, le recul de l’aide américaine pèse sur l’environnement du financement des start-up africaines, une préoccupation qui ne les a pas détournées du salon VivaTech 2025, où étaient présents plusieurs pavillons nationaux du continent.
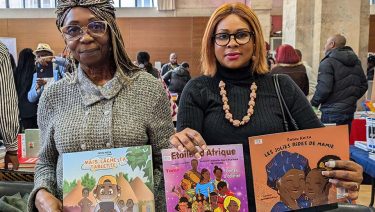
La littérature jeunesse africaine relie les enfants à leurs racines
Autrefois importés depuis l’Europe, les livres jeunesse intéressent de plus en plus les maisons d’édition africaines, qui ont à cœur de proposer des histoires ancrées dans la réalité des enfants. Mais malgré cet essor, les difficultés persistent.





