À Rome, la FAO et le Fonds international de développement agricole (Fida) coorganisent le Forum mondial sur l’agriculture familiale
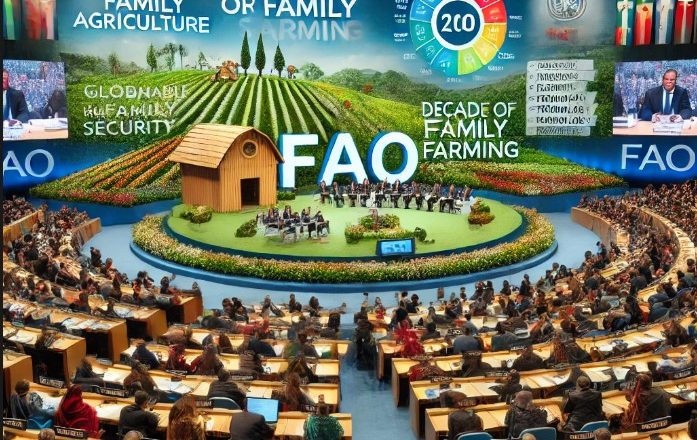
Plus de 1 000 participants dont des délégations de jeunes fermiers sont à Rome cette semaine pour cette manifestation qui s’inscrit à mi‑parcours de la Décennie des Nations unies pour l’agriculture (2019‑2028). Décryptage avec Guilherme Brady, chef de l’unité chargée de l’agriculture familiale, des réseaux parlementaires et de la communication au service du développement à la Division des partenariats et de la collaboration au sein du système des Nations unies (PSU).

Quels sont les points essentiels de ce Forum de l’agriculture familiale ?
D’abord, montrer l’importance de l’agriculture familiale à travers les expériences personnelles des participants. Puis identifier les innovations au niveau des politiques générales pour contribuer au développement de ce type d’activité. L’idée est aussi de déterminer des politiques prioritaires et des domaines techniques qui auront un impact sur l’agenda de la Décennie des Nations unies pour l’agriculture familiale (UNDFF) durant les cinq prochaines années.
Que faut-il entendre par agriculture familiale ?
Ce type d’activité désigne un mode d’organisation de la production agricole forestière, halieutique, pastorale et aquacole qui est gérée et exploitée par une famille. Elle repose principalement sur la main‑d’œuvre familiale des hommes et des femmes. L’agriculture familiale ne se limite pas à des opérations à petite échelle. La taille des exploitations peut s’étendre sur des petites, des moyennes ou des grandes surfaces, dans la mesure où la famille en assure principalement la gestion et l’exploitation. Cependant, l’agriculture familiale se différencie des entreprises agricoles qui sont exploitées à l’échelle industrielle et fonctionnent avec de la main‑d’œuvre embauchée par la propriété.
Que pèse l’agriculture familiale en Afrique ?
La prédominance des petites exploitations est plus importante dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. En Afrique subsaharienne par exemple, plus de 80 % des fermes font moins de 2 hectares et exploitent environ 30 à 40 % des terrains, un pourcentage plus élevé que dans d’autres régions. Toujours en Afrique subsaharienne, les petites fermes (≤ 20 ha) produisent plus de 75 % de la plupart des produits alimentaires. Toujours dans cette partie du continent africain, les toutes petites exploitations (≤ 2 ha) sont extrêmement nombreuses et contribuent à hauteur de 30 % à la plus grande partie de la production alimentaire. En résumé, l’agriculture familiale domine l’économie rurale des pays africains. Elle contribue à la sécurité alimentaire et constitue le socle des moyens d’existence de la famille d’exploitants. Ces fermes sont très différentes et elles appliquent un système d’agriculture mixte qui intègre la production végétale, l’élevage bovin et parfois aussi la pêche. Elles sont essentielles, car elles contribuent à l’alimentation des communautés locales, au maintien de l’emploi en milieu rural et à la préservation du savoir et du patrimoine agricoles.
L’agriculture familiale permet-elle d’accroître la substitution des importations par la production locale ?
L’agriculture familiale joue un rôle essentiel en maintenant un lien avec le territoire et en valorisant la production locale. Un grand nombre de pays africains essayent de plus en plus de réduire leur dépendance vis‑à‑vis des importations de produits alimentaires. Investir dans l’agriculture familiale peut permettre de booster la production nationale, relancer le contrôle et l’utilisation des ressources naturelles et favoriser l’accès aux marchés. Enfin, elle permet aussi d’intégrer des pratiques agroécologiques qui peuvent améliorer la production durable. Les familles d’agriculteurs peuvent pour leur part contribuer à la réduction de la dépendance des importations alimentaires et promouvoir la souveraineté alimentaire.
Quel est l’impact des changements climatiques sur ce système d’exploitation ?
Les exploitants familiaux africains sont particulièrement impactés par les changements climatiques, car ils n’ont pas toujours la possibilité d’accéder et de s’adapter aux technologies, aux systèmes d’irrigation, ou de bénéficier d’un soutien financier. Néanmoins, les agriculteurs familiaux jouent également un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique en adoptant des pratiques agroécologiques, en diversifiant les cultures et les techniques de conservation de l’eau. Dans la région du Sahel, par exemple, les exploitants familiaux qui affrontent le problème de la désertification et de la dégradation des sols sont en train de développer des stratégies innovantes comme l’agroforesterie et la collecte des eaux pour renforcer la résilience.
À voir aussi

Eliwilimina Buberwa présidente et fondatrice de l’ONG Msichana Imara Foundation
Dans cette interview, Initiative Africa donne la parole à Eliwilimina Buberwa, fondatrice de l’ONG Msichana Imara Foundation, engagée dans la lutte contre la précarité menstruelle en Tanzanie. À partir de son propre vécu, elle explique comment le manque d’informations, de produits et d’infrastructures adaptées prive encore des millions de jeunes filles de leur droit à l’éducation. Une discussion essentielle sur un enjeu de santé publique, d’égalité des genres et de justice sociale, au cœur des communautés rurales. Journaliste : Alexandra Vépierre

L’intelligence artificielle en Afrique : opportunités, défis et innovations
L’intelligence artificielle transforme le paysage économique mondial — et l’Afrique ne fait pas exception. Au Cameroun, la start-up Comparo accompagne les petites et moyennes entreprises grâce à une solution e-commerce automatisée et accessible, intégrant des outils puissants de ciblage et d’analyse. Mais au-delà des promesses, l’IA soulève aussi des enjeux majeurs : perte de contrôle des données, dépendance technologique, fractures sociales... Entre innovation locale et défis globaux, ce reportage explore les opportunités et les risques d’une transition numérique en pleine accélération.

Fania Niang – “Empreintes” : produire sa musique, relier l’Afrique et la diaspora
Avec Empreintes, son cinquième album, Fania Niang signe une œuvre intime et engagée, enregistrée à Dakar et produite pour la première fois de manière indépendante. Dans cet entretien, la chanteuse revient sur son parcours entre Afrique, Europe et États-Unis, sur les défis de l’autoproduction, et sur la rencontre musicale avec des artistes sénégalais ayant su dépasser les frontières culturelles. Elle partage aussi son regard sur la scène musicale africaine contemporaine, la place des artistes de la diaspora, et son désir de transmettre, aujourd’hui, ce qu’elle a appris au fil de décennies de création. Une conversation profonde sur la musique comme mémoire, comme pont entre les cultures et comme engagement social. Journaliste : Laurence Soustras

CLAYROCKSU, chanteuse de rock nigériane de premier plan
Elle a grandi en chantant à l'église et est devenue une figure emblématique de la scène rock nigériane. Dans cette interview exclusive, Clayrocksu se confie sur ce que signifie être une artiste rock et une femme dans un pays dominé par l'Afrobeats. De ses débuts où elle mêlait paroles en igbo et en anglais à la création d'une communauté de musiciens afro-rock, elle explique comment la musique est devenue pour elle une forme de rébellion, de guérison et d'affirmation identitaire. Entre foi, famille et passion, sa voix porte un message pour tous ceux qui se sentent différents et refusent de se conformer. Journaliste : Sharafa





