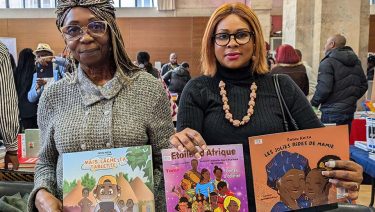Les cultures du pays bassari mises à l’honneur dans une exposition itinérante

Issue d’une collaboration entre les départements de Kédougou au Sénégal et de l’Isère en France, l’exposition Pays bassari met en lumière les cultures des minorités ethniques de ce territoire aux confins du Sénégal et de la Guinée. Après Grenoble, l’exposition devrait se rendre à Dakar et à Kédougou.
Rythme des saisons, rites initiatiques, objets sacrés et du quotidien, contes, croyances, instruments de musique… À travers des photos, des vidéos et des objets, l’exposition Pays bassari raconte, au Musée dauphinois de Grenoble (France) jusqu’au 8 septembre 2025, l’histoire et les pratiques culturelles des ethnies de ce territoire.
Situé entre le Sénégal oriental et la Guinée, le pays bassari accueille différentes ethnies – Bédik, Bassari, Coniagui, Djallonké, Malinké et Peuls –, pour une population totale estimée à 30 000 personnes. Mais si le territoire a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 2012, il reste pourtant méconnu, même au Sénégal. La volonté de valoriser ce patrimoine encore très préservé a donc motivé l’exposition.
Sortir des écueils du passé
Pendant 4 ans, les départements de Kédougou et de l’Isère ont travaillé « main dans la main pour ne pas tomber dans les écueils du passé colonial et être sur un même pied d’égalité, commente Olivier Cogne, directeur du Musée dauphinois. Les commissaires d’exposition viennent donc de l’Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN) et du musée des Civilisations noires de Dakar, tandis que le choix des images et des textes a été réalisé directement avec les habitants ». Pour l’occasion, 97 pièces ont été prêtées par l’IFAN de Dakar et le musée du quai Branly de Paris, tandis que 51 ont été collectées auprès des populations.
Les organisateurs ont ainsi collaboré avec l’Association des minorités ethniques (AME), qui fédère les ethnies autochtones du Sénégal oriental autour d’événements culturels pour préserver le patrimoine. Patrice Keita, coordinateur du projet, détaille : « Nous avons effectué des tournées dans les villages pour expliquer le projet et être sûr que la population y adhérait. Ensuite, des personnes ressources de chaque communauté ont partagé leur témoignage et sélectionné des objets importants pour leur ethnie afin de les mettre en avant dans l’exposition. »
Beaucoup de discussions ont été nécessaires pour comprendre ce qui pouvait être montré ou non. « Nous sommes arrivés à la conclusion que certains objets sacrés n’avaient pas leur place dans un musée. Nous avons donc décidé de les donner à voir via des photos ou vidéos, et de bien contextualiser ceux que nous exposions avec l’autorisation des habitants », précise Olivier Cogne.
Préserver des traditions en voie de disparition
Outre la mise en valeur de ce patrimoine, l’exposition permet aussi de le répertorier afin de préserver son effacement. Autrefois en quasi‑autarcie, le pays bassari connaît depuis le début du siècle des transformations profondes : construction de routes, développement du tourisme, diffusion du téléphone portable… Ce désenclavement provoque aussi le départ des plus jeunes vers les villes et l’abandon des cultures de tradition. « Le manque de transmission entre les générations devient très présent, s’inquiète Patrice Keita. Récemment, nous sommes allés dans un village malinké, réputé pour le tissage des habits. Les anciens regrettent que les plus jeunes délaissent cette pratique au profit du travail dans les exploitations aurifères ». Olivier Cogne voit alors que l’exposition a une « vocation à alerter sur ces situations de disparition culturelle qui touchent aussi les dialectes, partout dans le monde ». Néanmoins, Patrice Keita conçoit aussi la modernité comme une alliée : « Le numérique peut aussi nous aider à archiver et valoriser le patrimoine matériel et immatériel de cette région ». L’exposition pourrait également servir de matière pour les chercheurs.
Après Grenoble, les organisateurs sont en discussion pour envoyer l’exposition au musée des Civilisations noires de Dakar. Une version adaptée sera aussi présentée lors du Festival des ethnies minoritaires de Kédougou en octobre 2025, une manifestation créée par l’AME pour valoriser les cultures de la région et renforcer le lien entre les générations. Pour pallier le manque de lieux dédiés et s’adapter aux pratiques du public sénégalais, les organisateurs travaillent sur une version avec projections et rencontres avec des artistes. Une manière selon Patrice Keita de« préserver le patrimoine, notre identité et les racines de notre existence ».
À voir aussi

Eliwilimina Buberwa présidente et fondatrice de l’ONG Msichana Imara Foundation
Dans cette interview, Initiative Africa donne la parole à Eliwilimina Buberwa, fondatrice de l’ONG Msichana Imara Foundation, engagée dans la lutte contre la précarité menstruelle en Tanzanie. À partir de son propre vécu, elle explique comment le manque d’informations, de produits et d’infrastructures adaptées prive encore des millions de jeunes filles de leur droit à l’éducation. Une discussion essentielle sur un enjeu de santé publique, d’égalité des genres et de justice sociale, au cœur des communautés rurales. Journaliste : Alexandra Vépierre

L’intelligence artificielle en Afrique : opportunités, défis et innovations
L’intelligence artificielle transforme le paysage économique mondial — et l’Afrique ne fait pas exception. Au Cameroun, la start-up Comparo accompagne les petites et moyennes entreprises grâce à une solution e-commerce automatisée et accessible, intégrant des outils puissants de ciblage et d’analyse. Mais au-delà des promesses, l’IA soulève aussi des enjeux majeurs : perte de contrôle des données, dépendance technologique, fractures sociales... Entre innovation locale et défis globaux, ce reportage explore les opportunités et les risques d’une transition numérique en pleine accélération.

Fania Niang – “Empreintes” : produire sa musique, relier l’Afrique et la diaspora
Avec Empreintes, son cinquième album, Fania Niang signe une œuvre intime et engagée, enregistrée à Dakar et produite pour la première fois de manière indépendante. Dans cet entretien, la chanteuse revient sur son parcours entre Afrique, Europe et États-Unis, sur les défis de l’autoproduction, et sur la rencontre musicale avec des artistes sénégalais ayant su dépasser les frontières culturelles. Elle partage aussi son regard sur la scène musicale africaine contemporaine, la place des artistes de la diaspora, et son désir de transmettre, aujourd’hui, ce qu’elle a appris au fil de décennies de création. Une conversation profonde sur la musique comme mémoire, comme pont entre les cultures et comme engagement social. Journaliste : Laurence Soustras

CLAYROCKSU, chanteuse de rock nigériane de premier plan
Elle a grandi en chantant à l'église et est devenue une figure emblématique de la scène rock nigériane. Dans cette interview exclusive, Clayrocksu se confie sur ce que signifie être une artiste rock et une femme dans un pays dominé par l'Afrobeats. De ses débuts où elle mêlait paroles en igbo et en anglais à la création d'une communauté de musiciens afro-rock, elle explique comment la musique est devenue pour elle une forme de rébellion, de guérison et d'affirmation identitaire. Entre foi, famille et passion, sa voix porte un message pour tous ceux qui se sentent différents et refusent de se conformer. Journaliste : Sharafa