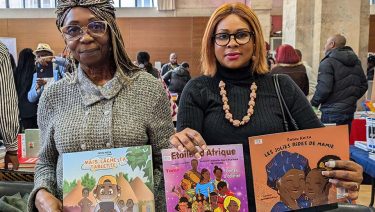« L’invité au Goncourt », un roman d’apprentissage entre Paris et le parc des Virunga

Publié le 13 septembre aux éditions Les Lettres Mouchetées, le roman « L’invité au Goncourt » retrace le parcours de Huzuni, auteur congolais épris de mots et d’animaux, dans son combat contre le braconnage. L’occasion de prôner l’émancipation par la littérature et le retour à la nature.
Écrit par Laurence Kiehl et Pascal Ashuza, le roman « L’invité au Goncourt » s’ouvre dans le frileux Paris, à l’intérieur du restaurant Drouant. Loin de la faune et de la flore luxuriante de son parc des Virunga, en République démocratique du Congo, l’écrivain congolais Huzuni attend de savoir s’il a reçu le Goncourt, le prestigieux prix littéraire français. Durant cette longue attente, il se remémore sa vie de jeune analphabète dans un village en bordure des Virunga devenu écrivain défendant la cause animale.
Véritable roman initiatique, « L’invité au Goncourt » est le fruit d’une collaboration insolite entre l’autrice française Laurence Kiehl et le poète congolais Pascal Ashuza qui se sont connus via un réseau social et ont décidé d’écrire un roman à quatre mains afin de mêler des thématiques qui leur sont chères : l’environnement et la littérature. Pourtant, ils ne se sont jamais rencontrés. Ils travaillent alors sur Google Docs, chacun à un bout de la planète. « Nos styles étaient d’abord assez hétérogènes, mais on a appris l’un de l’autre en laissant la liberté à chacun de s’exprimer, jusqu’à réussir à obtenir une forme d’homogénéité », raconte Laurence Kiehl, également professeur de français en Suisse.
Pascal Ashuza vivant près du parc des Virunga, ils décident de placer une partie de l’intrigue à cet endroit. « Je me suis inspiré de ce qui était autour de moi et je me suis beaucoup documenté. Le parc des Virunga est le premier parc d’Afrique, il a été construit en 1925 et abrite 706 espèces d’oiseaux ! », s’exclame l’auteur. Comme lui, le personnage du roman s’émerveille de la richesse inépuisable de l’environnement, mais fait aussi face à la dangerosité de l’humain. « Dans ce parc, comme dans beaucoup d’autres en Afrique, il y a ce contraste entre la beauté de la nature avec la sauvegarde des animaux et les tueries de ces mêmes animaux. Nous voulions rendre hommage à tous ces hommes qui se battent pour protéger les espèces », ajoute Laurence Kiehl.
Choqué par des scènes de braconnage, Huzuni décide peu à peu de faire partie de ceux qui protègent. « À travers ce roman, nous voulions montrer que, même sans avoir de gros moyens, nous pouvons réussir à soutenir une cause qui nous tient à cœur », explique le poète.
S’émanciper par la littérature
La construction du roman s’inspire des neuf cercles de l’Enfer, issus de la « Divine comédie » de Dante. « Chaque cercle est une étape à franchir par Huzuni pour aller plus loin dans sa détermination. Il vit dans des conditions infernales et chaque victoire peut mener son Afrique vers un paradis », détaille Laurence Kiehl. Tout le long, l’œuvre est truffée de références littéraires à des auteurs européens et africains. Le personnage lui‑même découvre la littérature et y trouve une voie d’émancipation formidable. « Dans le contexte de la négritude, les auteurs ont eu une démarche d’émancipation par la littérature. De la même manière, notre héros analphabète découvre les merveilles de la langue qui lui permettent de s’exprimer à son tour et de parler de la cause qu’il défend », reprend l’autrice. Tous deux amoureux des mots – Pascal Ashuza a lancé le site Le Live du livre, un magazine trimestriel et un podcast sur la littérature francophone –, les auteurs utilisent un vocabulaire riche, mêlant différentes langues, comme le kiswahili, et d’autres formes comme le conte.
Un brin moqueur face à la pédanterie de la littérature parisienne, le roman fait le lien entre la jungle des animaux et celle des hommes, quand le personnage se sent entouré d’auteurs‑prédateurs. C’est une belle occasion de s’interroger sur la place de la littérature africaine francophone dans la littérature globale. « Il y a énormément de talents en Afrique francophone. Si beaucoup d’auteurs africains gagnent des grands prix littéraires, ce n’est pas un hasard. Pour moi, ces auteurs se sont approprié la langue, en usent et s’en amusent », explique l’éditrice des Lettres Mouchetées, Muriel Troadec. Elle qui a fondé cette maison d’édition à Pointe-Noire en 2015 souhaite mettre en avant des auteurs africains sur des sujets de société comme l’environnement ou les droits des femmes.
Et la fin, ouverte, laisse la possibilité d’un deuxième tome. « Nous voulons développer davantage le métier de ranger,conclut Laurence Kiehl. Leur formation est très difficile et beaucoup d’hommes meurent dans l’exercice de leur fonction. C’est tout un sujet à traiter ».
À voir aussi

Eliwilimina Buberwa présidente et fondatrice de l’ONG Msichana Imara Foundation
Dans cette interview, Initiative Africa donne la parole à Eliwilimina Buberwa, fondatrice de l’ONG Msichana Imara Foundation, engagée dans la lutte contre la précarité menstruelle en Tanzanie. À partir de son propre vécu, elle explique comment le manque d’informations, de produits et d’infrastructures adaptées prive encore des millions de jeunes filles de leur droit à l’éducation. Une discussion essentielle sur un enjeu de santé publique, d’égalité des genres et de justice sociale, au cœur des communautés rurales. Journaliste : Alexandra Vépierre

L’intelligence artificielle en Afrique : opportunités, défis et innovations
L’intelligence artificielle transforme le paysage économique mondial — et l’Afrique ne fait pas exception. Au Cameroun, la start-up Comparo accompagne les petites et moyennes entreprises grâce à une solution e-commerce automatisée et accessible, intégrant des outils puissants de ciblage et d’analyse. Mais au-delà des promesses, l’IA soulève aussi des enjeux majeurs : perte de contrôle des données, dépendance technologique, fractures sociales... Entre innovation locale et défis globaux, ce reportage explore les opportunités et les risques d’une transition numérique en pleine accélération.

Fania Niang – “Empreintes” : produire sa musique, relier l’Afrique et la diaspora
Avec Empreintes, son cinquième album, Fania Niang signe une œuvre intime et engagée, enregistrée à Dakar et produite pour la première fois de manière indépendante. Dans cet entretien, la chanteuse revient sur son parcours entre Afrique, Europe et États-Unis, sur les défis de l’autoproduction, et sur la rencontre musicale avec des artistes sénégalais ayant su dépasser les frontières culturelles. Elle partage aussi son regard sur la scène musicale africaine contemporaine, la place des artistes de la diaspora, et son désir de transmettre, aujourd’hui, ce qu’elle a appris au fil de décennies de création. Une conversation profonde sur la musique comme mémoire, comme pont entre les cultures et comme engagement social. Journaliste : Laurence Soustras

CLAYROCKSU, chanteuse de rock nigériane de premier plan
Elle a grandi en chantant à l'église et est devenue une figure emblématique de la scène rock nigériane. Dans cette interview exclusive, Clayrocksu se confie sur ce que signifie être une artiste rock et une femme dans un pays dominé par l'Afrobeats. De ses débuts où elle mêlait paroles en igbo et en anglais à la création d'une communauté de musiciens afro-rock, elle explique comment la musique est devenue pour elle une forme de rébellion, de guérison et d'affirmation identitaire. Entre foi, famille et passion, sa voix porte un message pour tous ceux qui se sentent différents et refusent de se conformer. Journaliste : Sharafa