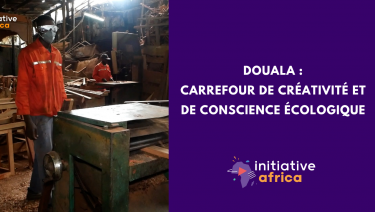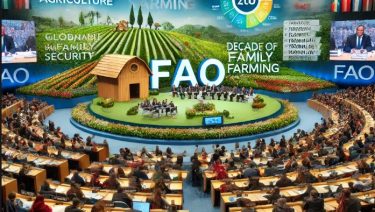L’échec du programme Sahel Vert au Cameroun ?

Avant la Grande muraille verte d’Afrique, le programme Sahel vert a été mis en place depuis les années 80 au Cameroun. Mais il est aujourd’hui controversé. Au nord du pays, les terres à reboiser manquent et le rêve d’une muraille verte contre le Sahara apparaît pour le moment très compromis.
Dans l’espace garage du bureau régional de l’Agence nationale d’appui au développement forestier, plusieurs rangées de jeunes plants d’acacias sont à l’agonie. Narcisse Mbarga, le chef du bureau, fait arroser les pépinières en cette fin d’après-midi. Cela fait deux semaines que ces plants patientent : acacia, neem, anacarde, des espèces types pour stopper la progression du désert. Leur séjour ici ne devait pas excéder trois mois. Seulement, il est survenu un contretemps inattendu. « Les arbres ne se plantent pas sur la planète Mars », peste Narcisse, révélant le problème : pas de terres où planter… la énième embûche sur le chemin vers le Sahel vert.
Touche pas à ma terre !
La ville de Maroua, capitale régionale de la région de l’Extrême-Nord, est considérée comme zone écologique fragile du fait de l’avancée du désert. La menace est vieille, presque autant que certains titres fonciers dans la ville. « En 1980, lorsqu’on lançait la première phase de l’opération, j’avais déjà cédé cette parcelle-là au gouvernement », déclare Moussa Djibrine, indiquant un espace à perte de vue derrière sa concession du quartier Garoua Rey. À la vue de la forêt rabougrie, il est à peine moins énervé que Narcisse. Moussa et quelques autres propriétaires fonciers ont d’ailleurs contacté un avocat pour défendre leur cause face à l’État du Cameroun : « l’opération Sahel vert n’a pas réussi. Le désert avance. L’eau se recueille de plus en plus loin et le bois de chauffage est de plus en plus rare. Couper du bois sur ces arbres en train de sécher au soleil est désormais passible de prison. Qu’est-ce qui nous garantit que la nouvelle opération sera meilleure ? », argumente-t-il. Car, pour lui comme pour les autres membres de ce collectif de plusieurs dizaines de détenteurs de titres fonciers autour de la ville de Maroua, l’absence de moyens financiers condamne à l’échec toute initiative de reboisement. Les enjeux sont multiples et vont du simple approvisionnement en bois de chauffage, ressource essentielle pour la cuisson des aliments, à la disponibilité de l’eau potable, en passant par le développement de l’élevage et la reconstitution de bassins versants pour les retenues d’eau destinées aux cultures par irrigation.
Sahel vert, un éléphant blanc ?
La toute première riposte de l’État à l’avancée du désert, c’était dans les années 70. Elle prévoyait de replanter 100 000 hectares de forêt, et cela concernait 126 parcelles. La crise économique de 1987 à 1994 a compromis cette opération. Le conflit frontalier avec le Nigeria, le harcèlement par le groupe armé Boko Haram depuis 2011, un conflit séparatiste dans les provinces anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et des incursions de bandes armées centrafricaines à l’est du pays ont ajouté un grain de sable supplémentaire dans le mécanisme, retardant toute avancée significative.
La sylviculture pour remplacer Sahel vert.
L’État du Cameroun a lancé en 2020 un programme, baptisé Sylviculture de seconde génération, pour lutter contre les avancées du désert, boiser les zones arides, reboiser les forêts dégradées et fournir du bois de plantation à l’exportation.
Reboiser 12 millions d’hectares de forêt est l’objectif que le gouvernement camerounais s’est assigné à l’horizon 2045. Les espaces concernés sont à la fois des zones écologiques dites fragiles comme les steppes et aires désertiques du nord du pays, les forêts dégradées du centre et du sud Cameroun, ainsi que les unités forestières aménagées à l’est. Le programme mis en place pour conduire cette vaste opération est baptisé Sylviculture de seconde génération. Il consiste à créer pièce après pièce des forêts artificielles de neems, acacias ou anacardes, les variétés choisies étant fonction des zones écologiques à reconstituer.
Au-delà des problématiques planétaires du réchauffement climatique, la reconstitution de ce couvert végétal endommagé devrait aider à remettre sur pied les bassins versants pour la retenue des eaux d’irrigation. L’autre avantage espéré est celui de villes plus vertes, puisque 2 000 hectares de forêt urbaine doivent être plantés. Enfin, une cadence soutenue de 4 000 ha de replantation en forêt dégradée devrait suffire à rattraper les dégâts engendrés par la coupe sauvage de bois d’exportation.
Certaines propositions de financement de la campagne nationale de reboisement, qui devrait coûter près de 100 millions d’euros sur 25 ans, sont déjà assorties d’une condition : vendre du bois écologiquement « propre », c’est-à-dire issu de forêts artificielles.
À voir aussi

Eliwilimina Buberwa présidente et fondatrice de l’ONG Msichana Imara Foundation
Dans cette interview, Initiative Africa donne la parole à Eliwilimina Buberwa, fondatrice de l’ONG Msichana Imara Foundation, engagée dans la lutte contre la précarité menstruelle en Tanzanie. À partir de son propre vécu, elle explique comment le manque d’informations, de produits et d’infrastructures adaptées prive encore des millions de jeunes filles de leur droit à l’éducation. Une discussion essentielle sur un enjeu de santé publique, d’égalité des genres et de justice sociale, au cœur des communautés rurales. Journaliste : Alexandra Vépierre

L’intelligence artificielle en Afrique : opportunités, défis et innovations
L’intelligence artificielle transforme le paysage économique mondial — et l’Afrique ne fait pas exception. Au Cameroun, la start-up Comparo accompagne les petites et moyennes entreprises grâce à une solution e-commerce automatisée et accessible, intégrant des outils puissants de ciblage et d’analyse. Mais au-delà des promesses, l’IA soulève aussi des enjeux majeurs : perte de contrôle des données, dépendance technologique, fractures sociales... Entre innovation locale et défis globaux, ce reportage explore les opportunités et les risques d’une transition numérique en pleine accélération.

Fania Niang – “Empreintes” : produire sa musique, relier l’Afrique et la diaspora
Avec Empreintes, son cinquième album, Fania Niang signe une œuvre intime et engagée, enregistrée à Dakar et produite pour la première fois de manière indépendante. Dans cet entretien, la chanteuse revient sur son parcours entre Afrique, Europe et États-Unis, sur les défis de l’autoproduction, et sur la rencontre musicale avec des artistes sénégalais ayant su dépasser les frontières culturelles. Elle partage aussi son regard sur la scène musicale africaine contemporaine, la place des artistes de la diaspora, et son désir de transmettre, aujourd’hui, ce qu’elle a appris au fil de décennies de création. Une conversation profonde sur la musique comme mémoire, comme pont entre les cultures et comme engagement social. Journaliste : Laurence Soustras

CLAYROCKSU, chanteuse de rock nigériane de premier plan
Elle a grandi en chantant à l'église et est devenue une figure emblématique de la scène rock nigériane. Dans cette interview exclusive, Clayrocksu se confie sur ce que signifie être une artiste rock et une femme dans un pays dominé par l'Afrobeats. De ses débuts où elle mêlait paroles en igbo et en anglais à la création d'une communauté de musiciens afro-rock, elle explique comment la musique est devenue pour elle une forme de rébellion, de guérison et d'affirmation identitaire. Entre foi, famille et passion, sa voix porte un message pour tous ceux qui se sentent différents et refusent de se conformer. Journaliste : Sharafa