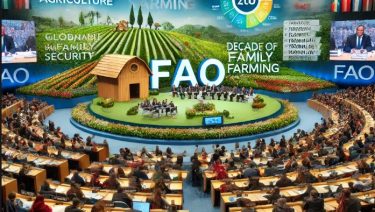La grande muraille verte : un rideau d’arbres contre le réchauffement climatique.

Selon certains experts, ce sera le plus grand organisme vivant sur la planète. La Grande muraille verte est une initiative lancée par l’Union africaine pour transformer la vie de 100 millions de personnes en cultivant une mosaïque d’arbres à même de restaurer les terres dégradées dans onze pays africains.
Burkina Faso, Tchad, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal et Soudan : onze pays qui attendent la huitième merveille du monde. On parle ici de la Grande muraille verte (GMV), une structure vivante cultivée de 8 000 km de long sur 15 km de large. À terme, elle traversera l’Afrique de part en part ; ce rempart d’arbres d’est en ouest du continent est constitué d’une mosaïque d’espèces végétales. La GMV est une initiative dirigée par l’Afrique, lancée par l’Union africaine en 2007 et conçue pour transformer la vie de 100 millions de personnes en restaurant les terres dégradées, en aidant les habitants de ces régions à produire une alimentation adéquate, et en créant des emplois, un gage pour la paix.
Un rêve nigérian
C’est le président Olusegun Obasanjo qui a lancé l’idée de cette offensive en 2002. En juin 2005, lors du septième Sommet des leaders et chefs d’État de la Communauté des États sahélo-sahariens à Ouagadougou (Burkina Faso), il propose une action concrète dénommée « Initiative de la Grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel ». O. Obansanjo vise une synergie d’actions sous-régionale permettant de faire face aux principaux fléaux environnementaux et climatiques. Ces leaders africains vont se retrouver en janvier 2007 à Addis-Abeba sous l’égide de l’Union africaine pour acter la naissance la GMV pour le Sahara et le Sahel.
Reboiser : le coup d’accélérateur de la France
La désertification, l’un des principaux défis de l’époque, a bouleversé les moyens de subsistance au Sahel et fait de la région l’une des plus pauvres du monde. L’accélérateur de la GMV, lancé par le président de la République française Emmanuel Macron à l’occasion de la 4e édition du Sommet One Planet à Paris en janvier 2021, a pour objectif de renforcer, coordonner et suivre la mise en œuvre de la GMV dans ses 11 États membres. La Commission de l’Union africaine et l’Agence panafricaine de la Grande muraille verte conduisent la manœuvre sur le plan institutionnel. Le soutien financier du gouvernement irlandais et de partenaires internationaux complète l’ingénierie déjà mise en place pour environ 100 millions d’hectares de terres dégradées à restaurer, 250 millions de tonnes de carbone séquestrées et dix millions d’emplois verts créés d’ici 2030.
Projet innovant et autres signaux positifs
Planter n’est plus l’unique objectif. Le chantier vivant de la GMV conjugue en plus un programme de développement rural sur toute la bande sahélienne. Des projets de gestion intégrée des écosystèmes engagent désormais des problématiques telles que la dégradation des terres et la désertification, les effets du changement climatique, la perte de biodiversité et la lutte contre la pauvreté, l’insécurité alimentaire et la hausse des conflits due à la raréfaction des ressources dans les pays du Sahel. Avec l’arrivée d’autres pays – Cameroun, Ghana, et quelques états d’Afrique australe –, la prise en compte de spécificités, comme l’environnement du lac Tchad, est greffée au rêve de l’ex-président nigérian. L’initiative est enfin inscrite parmi les dix programmes phares de l’O.N.U. en matière de restauration mondiale.
Un bilan encore mitigé, mais des débouchés économiques en vue
Vraie muraille verte ou îlots d’arbustes épars ? Quand on parle de la Grande muraille verte d’Afrique, les critiques ne manquent pas. Il y a tout d’abord la vision de nouvelles plantations vite fragilisées par la sécheresse et l’avancée de la désertification, la perplexité des habitants – et tout particulièrement des éleveurs – face à des tentatives de reboisement souvent vaines qui les privent de terres, et enfin le sentiment de manque de transparence sur les ressources financières pourtant considérables allouées au projet. Et ce, au point que l’expression « mirage de la Grande muraille verte » revient fréquemment dans les conversations. (Lien : Au Sénégal, le mirage de la « Grande muraille verte » (reporterre.net)) Un fait est avéré : le vaste projet de reboisement a fortement pâti de l’instabilité géopolitique dans plusieurs pays du Sahel, l’insurrection de Boko Haram rendant impossible son déploiement dans des régions entières. Au point qu’aujourd’hui la commune de Téssékéré au Sénégal, où ont été effectuées les premières plantations dès 2008, apparaît toujours comme la vitrine et le laboratoire avancé de la Grande muraille verte d’Afrique. À l’actif de ce pays d’Afrique de l’Ouest : le reboisement de 65 000 hectares et des initiatives pour vaincre les réticences des éleveurs peuls. (Lien : https://www.oecd-forum.org/posts/la-grande-muraille-verte-un-defi-ecosystemique-pour-l-afrique.) Mais cela ne signifie pas que le reste de l’Afrique reste inerte. D’autres programmes, moins connus, sont ainsi à l’œuvre à l’est du continent. Lors du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial le 22 juin à Paris, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a mis l’emphase devant un parterre de dirigeants internationaux sur le programme de reboisement de son pays : il a déjà abouti à la plantation de 25 milliards de jeunes plants entre 2019 et 2022 et à la création de 125 pépinières pour les conditionner. Le futur de la Grande muraille verte tourne désormais autour de la sélection végétale et de la manière dont l’Afrique pourrait capter une plus grande partie du marché des produits biologiques et également de celui des cosmétiques estimé à 240 milliards de dollars. Selon un rapport commandé par le World Economic Forum (Lien The Untapped Potential of Great Green Wall Value Chains: An Action Agenda to Scale Restoration in the Sahel | World Economic Forum (weforum.org)), neuf des plantes sélectionnées pour leur résistance au stress hydrique le long de la Grande muraille verte offrent un potentiel économique important dont il faut développer la chaîne de valeur. On y trouve notamment l’Acacia senegal – dont on extrait la gomme arabique –, le baobab d’Afrique, le dattier du désert, le moringa et le karité.
L.S
LA SEMAINE PROCHAINE, LA SUITE DU DOSSIER: LE PROGRAMME SAHEL VERT DU CAMEROUN
À voir aussi

Minerais: l’Afrique avance vers ses objectifs de transformation locale
Le continent, de plus en plus courtisé internationalement pour ses minerais critiques, réclame davantage de moyens lui permettant de partager ses ressources.

Entretien avec Ikechukwu Anoke, dirigeant et co-fondateur de Zuri health
Un médecin pour 10 000 habitants, 65 % des utilisateurs de téléphones sans accès à internet : ZuriHealth répond à l'urgence sanitaire en Afrique avec des solutions innovantes et inclusives. Dans cet entretien, le PDG Ikechukwu Anoke présente cette plateforme d’hôpital virtuel accessible à tous, via SMS ou smartphone, qui rend les soins abordables, même à moins de 10 centimes par jour. Née d’une histoire personnelle, ZuriHealth est aujourd’hui active dans 9 pays et vise une présence dans les 55 États africains d’ici 3 ans.

Cosmétique beurre de karité made in Burkina
À Ouagadougou, le laboratoire Odiss Cosmétiques redonne vie aux peaux abîmées grâce à des ingrédients naturels 100 % locaux : beurre de karité, huile de neem, huile de baobab… Fondée par Denise Odette Konseiga, ancienne auxiliaire en pharmacie, cette entreprise made in Burkina s’impose comme une référence de la cosmétique réparatrice et responsable, dans un marché longtemps dominé par l’importation. 300 femmes mobilisées en coopératives, des gammes certifiées bio, une présence à l’international : Odiss mise sur le savoir-faire local et l’autonomisa Journaliste : Sonia KOCTY

Les start-up africaines préparent l’après-aide au développement
Cette année, le recul de l’aide américaine pèse sur l’environnement du financement des start-up africaines, une préoccupation qui ne les a pas détournées du salon VivaTech 2025, où étaient présents plusieurs pavillons nationaux du continent.